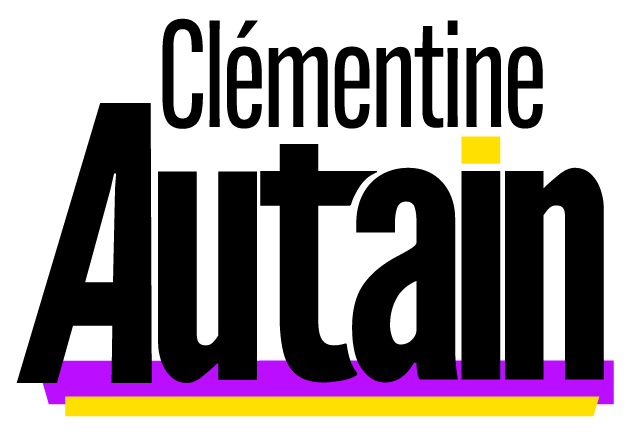Sérieux, c’est une épreuve.
Travailler à la maison en famille, avec des enfants qui, enfermés comme nous, sont régulièrement à cran, en mal d’activités, je dois dire que c’est du haut vol.
À cet instant, comme chaque matin où je m’astreins à écrire, il y a ce fond sonore de dessins animés qui bourrine mon crâne. Il faut que je me dépêche parce que les enfants devant les écrans toute la journée, ça donnerait des mollusques.
Depuis quinze jours, c’est la fête du Marmiton. Mon fils m’a même dit : « pourquoi tu ne te reconvertis pas en pâtissière ? ». C’est vrai que je surnage au milieu des quatre-quarts, des crêpes et autres crèmes brûlées. Faire à manger, j’adore parce que je ne fais pas suffisamment de choses manuelles, à part taper sur les touches de l’ordinateur. D’ordinaire, je n’ai pas le temps. Là, je le prends mais du coup, au moment où le rythme de la vie est totalement dissolu, j’ai un sentiment accru de courir après le temps.
Entre deux machines à laver et un coup d’aspirateur, une partie de Tarot et de Cluedo, une dictée et une leçon d’anglais, je vais m’enfermer dans une pièce pour une visio-conférence, forcément ponctuée par quelques « maman !!!!!!».
Travailler deux heures d’affilée, d’une traite, sans être interrompue ? Une gageure.
Alors tous les conseils nous invitant à profiter de ce temps pour lire, se poser, regarder des films que l’on a raté et je ne sais quoi encore, j’avoue que je ne me sens pas concernée.
Télé-travailler en famille, je ne sais pas si les employeurs mesurent bien la performance. Certains ont oublié, d’autres n’ont jamais connu, d’autres encore s’en fichent royalement. Les récits sur la pression mise par les dirigeants sur les cadres qui turbinent de chez eux, avec enfants – imaginez l’ambiance dans les familles monoparentales…. Les femmes prennent plus cher, c’est sûr… –, on en trouve partout sur les réseaux. Pourquoi perdre une occasion de nous essorer ?
Bon, je me suis quand même mise au yoga. Question de survie. Vingt à trente minutes par jour, pour que le corps se souvienne qu’il peut bouger. Pour respirer aussi.
C’est vrai, j’ai réussi à lire un roman, La femme révélée de Gaëlle Nohant. Mais c’est vraiment parce qu’il est sublime, d’une écriture incroyable. Une histoire de liberté, ça m’a fait du bien. Sinon, je m’endors comme une souche le soir.
Mais franchement, « le temps pour soi », « retrouver le goût de la culture », blablabla, des millions de foyers ne sont pas en état. C’est potentiellement juste une dose de culpabilité supplémentaire – l’incapacité à répondre à l’injonction.
Nous sommes assignés dedans, pétris de l’anxiété du dehors. On prend cher. Le coût sur la santé mentale et physique se mesurera à la sortie sans doute – mais quelle est, où est la sortie ? L’enfermement est une situation totalement dingue, qui rend dingue. Elle l’est d’autant plus que nous sommes cloisonnés dans l’angoisse avec le décompte quotidien des morts et le bout du tunnel que l’on n’entrevoit pas.
Nous vivons suspendus.
Et pourtant, chaque jour, je me dis : quelle situation privilégiée que de ne pas aller travailler dehors en prenant des risques pour la santé ! Je pense aux infirmières, aux chauffeurs de bus, aux livreurs, aux boulangers… à toutes celles et ceux qui partent bosser la boule au ventre.
Je sais bien, depuis longtemps, que la dureté pour les un.e.s n’apaise pas la douleur des autres. Il y a de l’irréductible dans la souffrance. C’est comme si pour calmer le mal-être d’une femme harcelée par son collègue, on lui disait : mais tu sais que des femmes sont lapidées à mort au Pakistan pour adultère ? Ou à une famille qui vit à six dans un deux pièces : regardez votre chance, il y a pire, vous pourriez vivre dans un bidonville ! Absurde.
En fait, c’est l’inverse. L’expérience de la souffrance crée de l’universalité. Cela ne signifie pas que nous vivons toutes et tous la même chose, tant s’en faut, mais que la crise sanitaire et la méthode du confinement nous font ressentir, chacun, chacune, fut-ce à des intensités bien différentes, une part de violence. Et elle donne à voir une communauté de destin.
Albert Camus ne disait pas autre chose : « C’était la grande leçon de ces années terribles que l’injure faite à un étudiant de Prague touchait un ouvrier de la banlieue parisienne et que le sang versé quelque part sur les bords d’un fleuve du centre européen allait amener un paysan du Texas à verser le sien sur le sol de ces Ardennes. […] L’enjeu était une dignité commune ».
Clémentine Autain
(Merci à Cyril Pedrosa pour l’illustration)