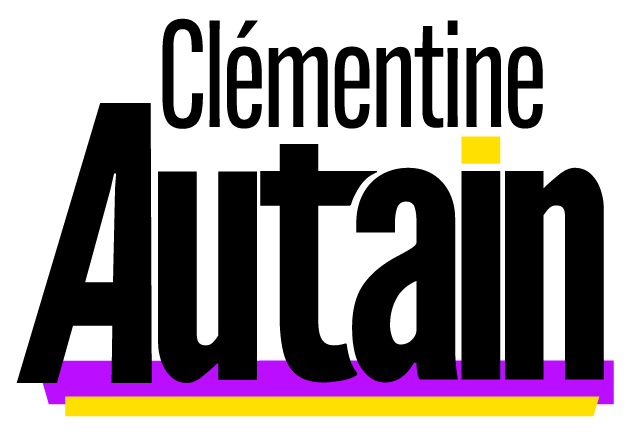C’est en lisant la magnifique biographie de Willy Gianinnazzi qui vient de paraître à La Découverte que j’ai eu l’idée de proposer une conférence sur André Gorz pour les Amfis d’été. Une façon de partager l’apport décisif de cet intellectuel dans ma construction politique mêlée à une volonté de donner envie de le lire ou le relire. Son écologie politique est d’une résonnance éclatante pour relever les défis de notre temps, sa pensée me paraît d’une fécondité sous-estimée. Même si je suis historienne de formation, c’est évidemment une lecture aussi subjective que politique de son œuvre que je livre ici. C’est pourquoi j’ai choisi de mettre l’accent sur deux questions qui me taraudent continuellement et auxquelles Gorz apporte des réflexions stimulantes : le lien entre écologie et capitalisme et l’enjeu du sujet de l’émancipation.
J’ai lu pour la première fois André Gorz lors de la parution de Lettre à D., une déclaration d’amour à sa femme qui démarre sur ces mots bouleversants : « Tu vas avoir quatre-vingt-deux ans. Tu as rapetissé de six centimètres, tu ne pèses que quarante-cinq kilos et tu es toujours belle, gracieuse et désirable. Cela fait cinquante-huit ans que nous vivons ensemble et je t’aime plus que jamais ». Quand ce texte paraît, André Gorz et sa femme Dorine viennent de se suicider ensemble, en septembre 2007. Lettre à D. est alors un succès de librairie et une occasion pour beaucoup de découvrir ou redécouvrir l’œuvre d’un grand intellectuel.
J’ai ensuite été percutée par les grands traits de sa pensée politique grâce au livre d’Arno Münster, André Gorz ou le socialisme difficile paru chez Lignes en 2008. Ce qui m’a alors marquée et profondément intéressée, c’est la façon dont Gorz inscrit son ancrage écologique dans un projet global anticapitaliste et aux dimensions économiques, sociales et culturelles. C’est bien une écologie radicale et non seulement environnementaliste, « romantique », qu’il vise. Et Gorz redoute un éco-fascisme.
Avant de le lire, j’avoue être circonspecte. Je le connaissais vaguement comme une figure de l’écologie politique et surtout comme un journaliste du Nouvel Observateur et il n’était clairement pas une référence pour l’ensemble des personnalités de culture marxiste que je prenais pour référence autour de moi. Et là, je découvre un intellectuel engagé, écrivain et philosophe, d’une culture profondément marxiste et pétrie d’existentialisme, que l’on peut qualifier de visionnaire à bien des égards. Gorz a contribué à la revue des Temps Moderne de Jean-Paul Sartre et en a même été le principal responsable de la rédaction entre 1965 et 1980. Journaliste sous le pseudonyme de Michel Bosquet, il a travaillé pour divers journaux « mainstream » de l’époque puis à L’Express et, à partir de 1981, au Nouvel Observateur.
Son vrai nom est Gérard Horst. Son père, petit industriel juif, s’appelait Hirsh et sa mère, Maria, était chrétienne, une femme dirigiste et peu aimante, obsédée par la réussite de ses deux enfants, par leur conformité avec les normes bourgeoises de la bienséance et la politesse. Gorz a grandi à Vienne puis sa mère l’a envoyé dans un pensionnat en Suisse. Si André Gorz se répand au cours de sa vie en pseudonymes, c’est comme il le dit ainsi dans Le traitre, ce livre philosophico-littéraire qui le pose comme figure intellectuelle en 1964, une « façon d’affirmer que le « moi » qu’il me faut bien être n’est qu’un travesti que je désavoue et que je n’entends me reconnaître que dans la voix nocturne et non identifiable de mes discours solitaires ». Personnage torturé, complexe, et complexé puisque Le traitre est l’histoire de ce jeune homme persuadé d’être nul et qui se débat avec sa nullité prétendue, pour ne pas dire présupposée, Gorz se sent exilé. En parlant de lui, il écrit dans Le traitre qu’« il n’était même pas le persécuté et l’exclu de toutes les communautés et entreprises, car nul n’avait pris le soin de l’exclure, on ne l’avait même pas gratifié de la réalité de traitre ou de transfuge. (…) Sa particularité était son absence de particularité : ni Juif, ni Allemand, ni Autrichien, ni Suisse, ni Français, ni réfugié, ni ami, ni ennemi, ni exploiteur, ni exploité, il n’était rien de tout ce par rapport à quoi il avait à se définir ».
Le fil de son essai se glisse d’une certaine façon entre Marx et Freud. Gorz postule la conjonction sur une personne entre des faits psychologiques, individuels, et l’impact d’un contexte social, culturel, historique. Ainsi, chacune, chacun créé sa propre histoire, son propre chemin à partir de données qui relève des deux domaines. Le personnage de Sartre, présent dans Le traitre sous le nom de Morel, lui dit qu’il ne peut pas juxtaposer les deux techniques. « Mais comment fonder cette unité en pensée sans que la pensée n’éclate ? », s’interroge-t-il. Tel est le pari de son cheminement, qui repose sur le postulat existentialiste : on est l’auteur de soi-même. Ou comme le disait Sartre : « l’homme est un être qui a à se faire libre ». André Gorz ajoute que même l’événement dépend de celui à qui il arrive : « quoiqu’il m’arrive, c’est moi qui arrive à moi ». C’est une entreprise de quête de liberté, reposant sur la capacité à devenir sujet de sa vie, qui est au fondement de son parcours personnel et intellectuel.
Sa pensée autonome s’émancipe progressivement de Sartre, notamment au début des années 1970 quand Sartre et Beauvoir opèrent une forme de tournant maoïste que Gorz ne suit pas. C’est aussi son attention à l’écologie qui le singularise : un tournant qu’il prend en 1970, moment où Gorz deviendra l’un des penseurs majeurs de l’écologie politique. C’est la rencontre avec Ivan Illich qui contribue alors à le tourner résolument vers une pensée anti-productiviste. Il est l’un des premiers à avoir fait le lien entre capitalisme et consumérisme. On retrouve aussi sous sa plume les influences de Hannah Arendt, Max Weber et l’école de Francfort, Gramsci. Le tout toujours en discussion avec Marx, jusqu’au bout.

Lien entre écologie et anticapitalisme
Nous sommes nombreux dans ma génération politique à avoir été impacté par un texte de la fin qui figure en tête du recueil posthume Ecologica paru aux éditions Galilée, comme toute son œuvre : « La sortie du capitalisme a déjà commencé ». Nous sommes en 2007 quand il décrit le phénomène de crise du capitalisme que l’on retrouve dans la crise des subprimes un an après ! Surtout, il lie capitalisme et productivisme de façon lumineuse. En partant du capitalisme, nous dit Gorz, on arrive immanquablement à l’écologie politique qui amène à radicaliser la critique du capitalisme.
En réalité, il y va fort dès 1977 sur ce lien présent dans Écologie et Liberté : « Le capitalisme de croissance est mort. Le socialisme de croissance, qui lui ressemble comme un frère, nous reflète l’image déformée non pas de notre avenir mais de notre passé ». C’est par la critique du modèle de consommation opulent que Gorz est devenu écologiste avant la lettre. Son point de départ : un article paru dans un hebdomadaire américain vers 1954. Il expliquait que la valorisation des capacités de production américaines exigeait que la consommation croisse de 50% de consommation supplémentaire au moins dans les huit années à venir mais que les gens étaient bien incapables de définir de quoi seraient faits leur 50% de consommation supplémentaire. Il revenait donc aux experts en publicité et marketing de susciter des besoins, des désirs, des fantasmes nouveaux chez les consommateurs, de charger les marchandises de symboles : « Le capitalisme avait besoin que les gens aient de plus grands besoins ». C’est ainsi que la consommation individuelle est promue (il faut que la consommation soit individualisée et privée pour être la plus rentable pour le capital) et avec elle leur durabilité, en visant à satisfaire le moindre petit besoin.
Le point qui m’est toujours resté en tête depuis ma découverte de Gorz est cette conviction : le capitalisme a deux leviers pour s’accroitre, les salaires et le consumérisme. Pour accroître le profit, il comprime les revenus du travail et crée des besoins pour vendre toujours plus des produits à l’obsolescence toujours plus grande.
A l’appui, il reprend une phrase de Marx dans le premier livre du Capital : « La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison de processus de production sociale qu’en combinant en même temps les deux sources d’où jaillit la richesse : la terre et le travailleur ».
La découverte de la finitude des ressources naturelles signifie d’abord pour Gorz une possibilité nouvelle de motiver la subversion du capitalisme. Une citation souvent reprise de Gorz l’exprime en ces termes : « L’utopie ne consiste pas, aujourd’hui, à préconiser le bien-être par la décroissance et la subversion de l’actuel mode de vie ; l’utopie consiste à croire que la croissance de la production sociale peut apporter le mieux-être, et qu’elle est matériellement possible ».
Dans Capitalisme, socialisme et écologie, Gorz nous dit en 1991 qu’il faut « soumettre le développement économique et technique à une modélisation et à des orientations réfléchies démocratiquement débattues ». Il s’agirait de rattacher les finalités de l’économie à la libre expression publique des besoins ressentis, au lieu de créer des besoins à la seule fin de permettre au Capital de s’accroître et au commerce de se développer. Il note la rupture du lien entre plus et mieux. Alors le superflu devient nécessaire. Les besoins sont considérés en fonction des besoins de rentabilité du capital : « Le capital se sert des besoins qu’il sert en vue de son propre accroissement, lequel demande en retour la croissance des besoins (…) La recherche de l’efficacité maximale dans la mise en valeur du capital exige ainsi l’inefficacité maximale dans la couverture des besoins : le gaspillage maximum ».
Gorz met également en cause ce que l’on pourrait appeler le consumérisme de la distinction. Par exemple, acheter un produit de luxe ne procure pas forcément une jouissance en soi. Si vous achetez un bijou chic ou de la mode haute couture, c’est la manifestation d’un pouvoir symbolique qui est en jeu, c’est pour accéder à des choses qui ne sont pas à la portée de tous. Ainsi, la seule fonction de cet achat est de rendre tangible une distinction sociale. On finit donc par avoir des acheteurs qui n’ont pas besoin des produits et ne désirent pas ce dont ils ont besoin ! La marque, comme l’a bien montré depuis Naomi Klein dans No Logo, au début des années 2000, devient une raison d’acheter et participe ainsi de la valeur du produit.
« Nous faisons l’expérience des coûts croissants pour des satisfactions décroissantes », tranche Gorz à la fin d’Ecologie et Liberté, livre qui se termine par le discours fantasmé d’un Président de la République énonçant la philosophie de son programme en trois points : 1- Nous allons travailler moins 2- Nous allons consommer mieux 3- Nous intégrerons la culture dans la vie quotidienne de tous. Aujourd’hui, nous sommes incapables de savoir ce dont on a réellement besoin. Nous sommes aliénés, et Gorz file toujours le concept d’aliénation qui lui paraît absolument décisif : « Nos désirs et nos besoins sont amputés, formatés, appauvris par l’omniprésence des propagandes commerciales et la surabondance des marchandises ».
Sa pensée l’amène tout naturellement à s’interroger sur ce qu’est la richesse et à critiquer la croissance, bien avant que cette critique ait pignon sur rue : « Les économistes, les décideurs, les hommes d’affaires réclament la croissance en soi, sans jamais en définir la finalité. Le contenu de la croissance n’intéresse pas les décideurs. Ce qui les intéresse, c’est l’augmentation du PIB, c’est-à-dire l’augmentation de la quantité d’argent échangé, de la quantité de marchandises échangées et vendues au cours d’une année, quelles que soient ces marchandises. Rien ne garantit que la croissance du PIB augmente la disponibilité des produits dont la population a besoin. Dans les faits, cette croissance répond d’abord à un besoin du capital, non aux besoins de la population ». Gorz fait dans le même temps le lien entre pauvreté et richesse : « La pauvreté signifie par définition privation de jouissances accessibles à d’autres : les riches. Pas plus qu’il n’y a de pauvres quand il n’y a pas de riches, pas plus il ne peut y avoir de riches quand il n’y a pas de pauvres : quand tout le monde est riche, personne ne l’est ; de même quand tout le monde est « pauvre ». À la différence de la misère, qui est insuffisance de ressources nécessaires pour vivre, la pauvreté est par essence relative ». A l’heure des discours sur le ruissellement et surtout d’une conviction largement ancrée dans les têtes selon laquelle il n’y a pas de rapport entre richesse et pauvreté, comme si on pouvait combattre la pauvreté sans toucher aux privilèges des plus riches, les formules limpides de Gorz me semble d’une belle actualité.
On comprend donc pourquoi Gorz définit ainsi l’enjeu politique majeur de notre époque : « c’est au niveau du choix de la production, au niveau de la définition du contenu des besoins et de leur mode de satisfaction, que se situe l’enjeu politique de l’antagonisme entre le capital et le travail vivant ». Oui, c’est bien là, dans « le pouvoir de décider la destination et l’usage social de la production, c’est-à-dire le mode de consommation auquel elle est destinée et les relations sociales que ce mode de consommation détermine ». Le mouvement ouvrier avait polarisé sa réflexion et son action sur le partage des richesses. Avec Gorz et l’écologie politique, on comprend qu’il faut désormais s’attacher et imbriquer une autre question : qui décide de ce que l’on produit ?
On l’aura compris : en partant du capitalisme, on arrive immanquablement à l’écologie politique qui amène à radicaliser la critique du capitalisme. Mais, nous dit Gorz, dans un entretien réalisé pour Ecorev par Marc Robert en 2005 et que l’on trouve en introduction de Ecologica, « si tu pars en revanche de l’impératif écologique, tu peux aussi bien arriver à un anticapitalisme radical qu’à un pétainisme vert, à un écofascisme ou à un communautarisme naturaliste. L’écologie n’a toute sa charge critique et éthique que si les dévastations de la Terre, la destruction des bases naturelles de la vie sont comprises comme les conséquences d’un mode de production ; et que ce mode de production exige la maximisation des rendements et recourt à des techniques qui violent les équilibres biologiques ». Du grain à moudre pour bien inscrire notre écologie dans une perspective globale d’émancipation humaine…
La question du sujet
L’écologie politique de Gorz l’amène à s’intéresser à une question stratégique majeure : qui est le sujet de l’émancipation ? Et sa proposition heurte les fondamentaux à gauche.
« L’idée que production et consommation puissent être définies en fonction des besoins est politiquement subversive. Cela suppose que ceux qui produisent, ceux qui consomment puissent se rassembler, réfléchir et décider souverainement. Ce but-là est négation radicale de la logique capitaliste », nous dit l’intellectuel engagé. Dès lors, ceux qui peuvent pousser à ça ne sont plus les prolétaires de Marx ni les ouvriers de l’industrie. Telle est sa conviction que l’on retrouve notamment dans ses Adieux au prolétariat, un livre qui a évidemment choqué chez les marxistes, mais aussi dans Misères du présent. Richesses du possible et dans Métamorphoses du travail.
Ce qu’il analyse, c’est le post-fordisme, c’est-à-dire cette période qui est la nôtre d’un « capitalisme avancé ». Selon Gorz, les ouvriers ne vendent plus leur force de travail pour consommer des produits utiles à un progrès de leur condition de vie et en s’appuyant sur un rapport de force construit collectivement, dans l’usine, avec les syndicats, pour obtenir des compromis avec le patronat. Comme le capitalisme a une capacité exceptionnelle d’adaptation pour maintenir son pouvoir, c’est par des voies indirectes qu’il assoit sa nouvelle domination. Gorz observe que c’est en dehors du travail-emploi et de ses contraintes hiérarchiques internes que la pression s’exerce désormais, en prenant « la forme d’un conditionnement qui conduit le sujet à accepter ou à choisir cela précisément que l’on entend lui imposer. Le front se trouve alors partout où l’information, le langage, le mode de vie, les goûts, les modes sont produits et façonnés par les forces du capital, du commerce, de l’État et des médias ».
L’armée de réserve dont parle Marx fonctionne à plein : il faut avoir un emploi. Le contenu, le sens, la fonction du travail deviennent secondaires. La pression du chômage et de la précarité prend le dessus. Là où Marx espérait que le prolétariat arriverait à s’unir en vue de contrôler la production, Gorz observe un phénomène d’éclatement du prolétariat et leur aliénation dans la société consumériste. Le capitalisme avancé a fait éclater l’unité de la vie et l’unité du travail. L’insécurité du travail et du revenu est une arme absolue. « Craignez, tremblez », le message idéologique a changé : « Qu’importe le montant de la paie pourvu que l’on ait l’emploi ». Autrement dit, « soyez prêt à toutes les concessions, humiliations, soumissions, compétitions, trahisons pour obtenir ou conserver un emploi », car « qui perd l’emploi perd tout ». Tel est le discours dominant exaltant la centralité du travail conçu comme une marchandise, quelque chose que l’on a ou que l’on n’a pas, comme un bien, et non pas comme quelque chose que l’on fait, comme un bien pour la possession pour lequel il faut être prêt à des sacrifices. Car désormais ce n’est pas le travail qui crée la richesse, c’est la richesse (celle des autres) qui crée du travail. Ainsi le travail devient un bien et l’emploi, un privilège. Avec les machines et la productivité qui grandit, on a de moins en moins besoin de travail pour produire des richesses, nous dit Gorz. Alors la société va se donner du mal pour inventer du travail et vous rendre socialement indispensable le travail-emploi. Énorme supercherie.
L’intellectuel met en avant une nouvelle dichotomie dans le monde du travail-emploi. D’un côté, ceux qui travaillent énormément et sont inclus à l’entreprise, pour devenir eux-mêmes l’entreprise, selon le nouveau précepte en vogue : « tu te réaliseras par l’entreprise ». De l’autre, les chômeurs, intérimaires, employés d’entreprises sous-traitantes, précaires en tous genres qui tantôt travaillent (pour gagner leur vie) et tantôt ne travaillent pas : « Nous nous savons, sentons, appréhendons chacun comme chômeur en puissance, sous-employé en puissance ». C’est pourquoi, selon André Gorz, la figure centrale n’est plus celle du travailleur, ni a fortiori de l’ouvrier, de l’employé, du salarié, mais celle du précaire qui incarne, même si nous n’en avons pas pleinement conscience, la condition « normale » de la société du capitalisme avancé. Une élite est gagnée, au nom de l’éthique du travail, à la collaboration avec le capital avec l’idée que l’individu va s’épanouir personnellement en servant l’entreprise. Et la masse est précarisée ou marginalisée, servant d’armée de réserve à une industrie qui veut pouvoir ajuster rapidement les effectifs employés aux variations de la demande. Il s’agit également de « détacher cette élite ouvrière de sa classe d’origine et des organisations de classe, en lui conférant une identité et une dignité socialement distinctes ». Un monde dualisé se construit entre « ceux qui se battent et qui gagnent », et méritent ainsi un statut distinct, de la masse « des allergique à l’effort ».
Pour Gorz, le remède n’est pas de « créer du travail » mais de répartir au mieux tout le travail socialement nécessaire et toute la richesse socialement produite. Cela suppose que le capital cesse sa domination sur le travail et que la personne puisse s’épanouir dans la multiactivité, dans une société du temps libéré chère à l’intellectuel. La tâche est difficile parce qu’il faut solidariser des forts avec des faibles dans un projet commun aux motivations culturelles, morales, politiques. « La dualisation de la société sera enrayée, puis inversée non pas par l’utopie d’un travail passionnant et à plein temps pour toutes et tous, mais par des formules de redistribution du travail qui en réduise la durée pour tout le monde, sans pour autant le déqualifier, ni le parcelliser ». En un mot, l’enjeu est alors la réunification des producteurs et des consommateurs, « des producteurs associés » comme disait Marx.
Gorz est connu dans le débat public comme un défenseur du revenu universel. La réalité de sa position sur le sujet est en réalité plus complexe. L’intellectuel se rallie à cette proposition à la fin de sa vie après avoir discuté et critiqué l’idée d’un revenu universel inconditionnel. Dans les années 1990, il passe beaucoup de temps à expliquer sa conception du revenu social : « un revenu continu pour un travail discontinu » car « on ne peut vouloir fonder ni une citoyenneté, ni un sentiment d’appartenance véritable à une société sur le fait qu’elle vous donne sans que vous ayez la possibilité de rien donner en retour ». Sa conviction au long court est la dénonciation du travail-marchandise qui dévalorise les métiers et les savoir-faire, qui dépossède les individus de leur capacité à devenir libres. C’est aussi la nécessité de la réduction du temps de travail au nom de la productivité grandissante, notamment avec les progrès de la technique, de la satisfaction des besoins loin du consumérisme dévastateur et de la démarchandisation du temps de travail pour pouvoir profiter de la vie et se faire libre. C’est enfin une proposition stratégique pour combattre le pouvoir du capital. Rien à voir avec une version libérale du revenu universel. S’il se laisse convaincre finalement par la logique du revenu universel, il me semble que l’on peut trouver dans le fil de sa pensée des éléments alimentant différentes formes de solutions pour une société qui attribue revenu et travail de façon plus juste, plus soutenable, plus égalitaire.
Cet exemple du revenu universel permet de souligner que son œuvre, comme toutes les œuvres, ne donne évidemment pas clés en main les réponses à tout. J’ai par ailleurs des désaccords avec certaines de ses approches, même si je n’en fais pas ici le tour. Je ne soulignerai pour finir qu’un point qui m’apparaît comme une faille majeure : le féminisme. À l’évidence, c’est une problématique qui n’irrigue pas son fil de pensée, sur le revenu universel comme sur d’autres questions.
L’exemple du revenu universel indique également les enjeux d’héritage autour d’André Gorz. Je suis frappée qu’il soit finalement peu cité, peu repris, dans les rangs de la gauche de transformation sociale et écologiste. Je crois son œuvre insuffisamment connue et partagée pour ne pas être réduite à des lectures partielles voire tronquées. Or, pour qui prétend mêler le rouge et le vert, la pensée d’André Gorz est d’une grande fécondité. Il donne non seulement à penser mais aussi de l’énergie pour agir. André Gorz nous invite en ouverture de Misère du présent, Richesse du possible à « apprendre à discerner les chances non réalisées qui sommeillent dans les replis du présent ».