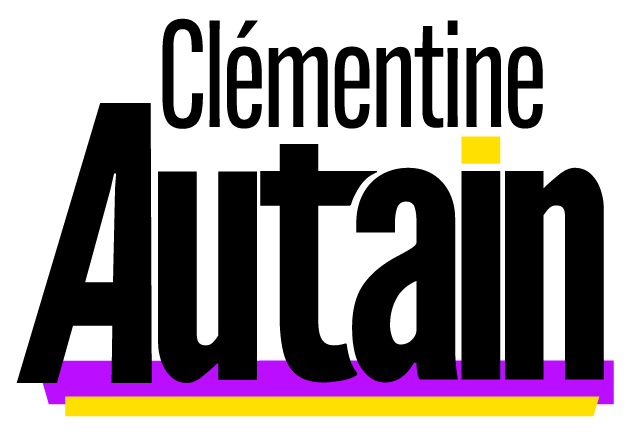LE COVID MET À NU LE CAPITALISME
En pleine crise sanitaire, notre modèle économico-social est brusquement mis à nu. Nos sorts se révèlent liés face au coronavirus là où le capitalisme nous avait tant habitué, façonné, contraint à l’éclatement et à la concurrence généralisée.
Nous redécouvrons les bienfaits des services publics et de l’entraide, qui sont nos biens les plus précieux pour vaincre le coronavirus, non pas dans le cadre d’une guerre (mes enfants, qui ont entendu le Président de la République, répètent maintenant en boucle : « nous sommes en guerre ! ») mais d’un drame sanitaire.
Peut-être réalisons-nous aussi le caractère marchand et machinal de nos vies. Durement entravés dans notre liberté, comment ne pas penser à ce dont nous avons réellement besoin, aux activités essentielles à la vie ?
La santé arrive aujourd’hui en tête là où les restrictions budgétaires avaient frappé. L’austérité a conduit à fermer des dizaines de milliers d’emplois et 69.000 lits en quinze ans, et donc à économiser sur les conditions de soins, sans susciter de vagues de mobilisation dans tout le pays pour empêcher un tel carnage. Breaking news : avec les personnels médicaux, les enseignants, les salariés qui s’occupent des ordures ménagères ou ceux qui font tourner l’eau, le gaz et l’électricité sont plus nécessaires que les traders, les courtiers en assurance ou les fabricants de luxe. Dans l’échelle de la considération sociale et des revenus, ces professions si utiles ne sont pourtant pas les mieux dotées. Isolés, nous sommes aussi nombreux à implorer un accès illimité à la production culturelle parce qu’elle nous donne une ouverture sur le monde qui nous est fermés, parce qu’elle nous accompagne dans la quête de sens, parce qu’elle nous fait rêver, ce qui n’est pas futile mais essentiel. Ce n’est pourtant pas un secteur qui, ces derniers temps, est choyé par les gouvernements successifs dans l’objectif de diversifier la création, protéger les artistes et techniciens, développer le partage…
Je formule l’espoir que nous soyons donc face à la question : qui décide de ce que l’on produit et met en commun, de ce qui est important pour faire société et favoriser l’émergence d’individus libres ?
Pour l’heure, nous sommes enfermés dans un cadre, le capitalisme, qui porte en lui la loi du profit. L’activité économique s’y trouve organisée autour de l’impératif de rentabilité pour ceux qui investissent des capitaux. Ce n’est donc pas le bien commun qui est le moteur de l’activité humaine. Les États n’ont cessé de céder du terrain au monde la finance et de démanteler la puissance publique, et avec elle les services publics et protections. À toutes les échelles, la concurrence en lieu et place de la coopération a de facto été organisée. Pour être compétitif du point du vue du capital, il faut tirer vers le bas le « coût » du travail et vers le haut la pulsion consumériste. Une crise sanitaire de l’envergure que nous traversons avec le coronavirus montre que cette logique ne permet pas de répondre aux besoins de la population.
Les dégâts du court-termisme nous sautent au visage. La recherche en est une illustration évidente. Règle d’or oblige, nous lui avons tourné le dos. La bourse en est une autre : elle flanche dès les prémisses de la crise sanitaire, mettant en péril le système économique au moment où nous aurions besoin de mécanismes protecteurs. Qu’importe, les risques ne doivent pas être pris par ces détenteurs de capitaux, et ils compteront quand même sur les aides publiques européennes pour renflouer les pertes. Que dire aussi de ces grandes entreprises qui espèrent s’en sortir voire en profiter, à coup de flambée des prix s’il le faut et sur le dos des salariés sommés de travailler dans des conditions non protectrices du virus, même pour produire des biens non indispensables, démontrent la folie de la logique en vigueur ? L’humain n’est pas la priorité. Ce sont la rentabilité et la compétitivité devant lesquelles se courbe l’échine.
Les dangers de la spécialisation de la production et avec elle, la sous-traitance de certains biens à d’autres pays, se révèlent aussi catastrophiques. Pour expliquer la pénurie de masques FFP2, le ministre Olivier Véran vient d’expliquer que la France a changé sa doctrine il y a dix ans : « jusqu’en 2010, il y avait un stock d’État d’un milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques FFP2. À la suite de l’épisode épidémique de grippe H1N1 de 2011, il a été décidé que ces stocks ne s’imposaient plus, la production mondiale de masques étant supposée suffisante. (…) Nous avons abordé cette épidémie dans une situation très dégradée, avec un stock nul en FFP2 et à peine 150 millions de masques chirurgicaux adultes et pédiatriques. » Le problème se pose également, par exemple, pour le paracétamol. La relocalisation de l’économie et la souveraineté dans des domaines vitaux, comme la santé ou l’alimentation, supposent de changer les priorités et les normes de production.
Le défi climatique aurait dû déjà nous conduire à ces conclusions. Car la folie productiviste qui dévaste l’écosystème et la santé est encouragée par la quête infinie du profit à court terme. Le coronavirus fait figure de répétition si l’on songe aux catastrophes liées au réchauffement climatique qui nous attendent à brève échéance. Si nous savons saisir les données du problème et repenser l’organisation économico-sociale à partir des besoins et non du profit, nous pouvons tracer un chemin de résilience.
Nous ne basculerons pas du jour au lendemain dans une société débarrassée des normes capitalistes et consuméristes, notamment en raison de sa globalisation, aussi à cause de façons de vivre ancrées dans nos habitudes et qui ne peuvent donc changer du tout au tout à une courte échelle temporelle. Mais nous pouvons choisir d’en favoriser ou d’en contraindre les mécanismes. Nous pouvons arrêter de nous désarmer en stoppant l’austérité et en mettant fin à la technocratie acquise aux logiques néolibérales qui gouvernent.
Aujourd’hui, nous faisons face à l’urgence et le temps du débat de fond, structurel, n’est pas encore ouvert. Je crois qu’il germe dans les têtes et notre tâche sera de le mener.
Clémentine Autain