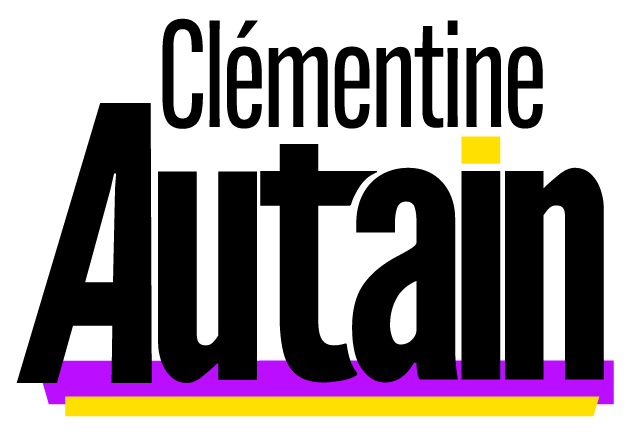Il y a quelques semaines sur France Inter, j’exprimais mon doute sur l’introduction de la notion de consentement dans la loi sur le viol. Le livre de la philosophe Geneviève Fraisse, Du consentement, que j’ai lu à sa sortie en 2007 et qui m’a durablement marquée, a refait surface. Ma propre expérience du viol et mon engagement de longue date sur le sujet ont fait le reste : depuis que ce débat est ouvert, je ressens un doute, je ne suis a priori pas convaincue. Parce que le consentement est un mot ambigu. Il a trait à l’attitude de la victime et non de l’agresseur. Et il ne rend pas compte des rapports de domination.
Au pied du mur du vote à l’Assemblée nationale, je suis sortie de l’hésitation : je voterai contre la proposition de loi portée par ma collègue Sarah Legrain et le groupe insoumis, avec lesquels je partage pourtant le combat contre les violences faites aux femmes. Nous sommes d’ailleurs de très nombreuses féministes, personnalités ou associations, à contester ce texte – et ce d’autant qu’il est présenté avant les conclusions d’une mission parlementaire de la délégation aux droits des femmes sur ce sujet. Les comparaisons internationales ne plaident pas en sa faveur. Pour faire reculer ces violences, l’essentiel est ailleurs que dans la définition juridique du viol.
Une notion ambigüe
D’abord, cette question simple : peut-on clarifier la définition du viol en introduisant une notion floue ? Le vieux proverbe « qui ne dit mot consent » exprime toute son ambigüité. Le consentement a deux facettes : l’accord, l’adhésion à ce qui est proposé par quelqu’un d’autre, et l’acceptation, voire la soumission au désir de l’autre. Car si consentir signifie exprimer son approbation, on peut aussi consentir dans le cadre d’un rapport de force. Un violeur peut, par sa position dominante – de genre, financière, professionnelle, familiale, physique, etc. – obtenir le consentement d’une victime. Cette dernière aura pesé le pour et le contre, et préféré subir que de refuser. Car les viols sont majoritairement commis dans un contexte d’inégalité et de dépendance. Il est donc facile d’extorquer un consentement.
Au fond, ce que ne restitue pas la notion de consentement, ce sont les rapports de domination hommes/femmes. Jusqu’au début du XXIe siècle, on peut trouver un dictionnaire capable de définir le mot consentant par « ne se dit guère que des femmes ». Cela devrait nous rendre prudents sur le recours à ce terme. Consentir, c’est davantage accepter qu’adhérer. Or les conditions pour dire « oui » ne sont pas indépendantes de l’état des relations entre les sexes dans une société donnée. Dans un contexte inégalitaire, le consentement porte le risque de n’être que « l’acceptation tacite d’une domination », pour reprendre les termes de l’anthropologue Nicole-Claude Mathieu.
La preuve par l’international
Tout cela peut sembler très philosophique quand l’urgence est concrète : faire reculer les violences faites aux femmes. Et après tout, si l’introduction du consentement dans la loi permettait d’en finir avec ce chiffre ahurissant : seuls 1% des viols aboutissent à une condamnation, ne faudrait-il pas s’en satisfaire ? Là résidait mon hésitation avant d’aller voir ailleurs ce qu’il en est…
Dans les pays où le consentement a été inscrit dans la loi, l’impunité n’a pas reculé et on constate même parfois une diminution des condamnations – sauf en Suède où la loi précédente comportait une définition si restrictive du viol qu’elle n’avait quasiment pas d’effet. Au Canada où le consentement est dans la législation, le taux de condamnations au regard du nombre d’agressions signalées est équivalent à celui français. Au Royaume-Uni, après la loi introduisant le terme, le nombre des condamnations pour viol a presque été divisé par deux. En Belgique, le rapport d’Amnesty International de 2022 pointe parfaitement la situation : « la victime sur qui repose la charge de la preuve et qui doit donc prouver qu’elle n’a pas consenti, peut faire face à des commentaires tels que : « si elle est montée dans sa chambre, c’est qu’elle était consentante », « si elle s’est habillée ainsi, c’est qu’elle avait envie et donc qu’elle était consentante », « si elle n’a pas dit non, c’est qu’elle était consentante »…
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le consentement inscrit dans le marbre juridique ne change pas la donne. Pour l’Union syndicale de la magistrature (USM), la définition actuelle du viol en France paraît satisfaisante car elle permet d’englober une multitude de situations. La jurisprudence donne en effet à voir qu’en l’état, elle est en capacité de couvrir toute la palette des situations – en principe, car c’est évidemment une autre affaire dans la réalité, ce qui peut inviter les législateurs/trices à préciser la définition mais l’on voit bien que là n’est pas l’élément déterminant. Le défaut de preuve matérielle, qui est en partie lié au manque d’investigation, est en réalité la plus grande difficulté à laquelle nous sommes confrontés, et modifier la définition du viol n’y changera rien. En tout état de cause, il ne faudrait pas qu’une nouvelle rédaction vienne fragiliser les victimes.
Le procès de la victime ?
En réalité, les enquêtes et procès tournent déjà autour de la question du consentement. Le procès de Mazan montre à quel point, même en cas de soumission chimique, la victime doit se justifier : Gisèle Pélicot est suspectée d’avoir été volontaire dans un jeu libertin. Généralement, les violeurs et agresseurs ne nient pas l’acte sexuel mais prétendent qu’il est consenti. Est-ce qu’une définition précise de ce que signifierait un consentement pourrait aider police et magistrats ? Ce n’est pas le cas de la proposition de loi soumise au vote de l’Assemblée qui pose le terme sans lui donner une pleine compréhension de ce qu’il recouvre. Mais comme le note Anne Bouillon, juriste spécialiste des violences faites aux femmes, « venir caractériser ce qui manifeste un consentement plein et entier, évidemment, c’est une question délicate »… Les victimes ont-elles eu la liberté de dire non ? Ont-elles réellement désiré cet acte sexuel ? Ce sont plutôt les notions d’emprise et de sidération qui aident à comprendre les mécanismes de la majeure partie des violences sexuelles.
L’inquiétude, c’est que la victime soit plus encore au centre du procès, et non le violeur. Les femmes et le ministère public risquent de devoir plus encore prouver l’absence de consentement. Les avocats des agresseurs seront davantage portés à analyser l’attitude de la victime pour débusquer ce qui a pu signifier qu’elle était d’accord. En outre, le consentement s’intéresse à la dimension immédiate de l’acceptation alors que, dans la plupart des cas, ce qu’il faut comprendre, c’est le phénomène plus ancien, qui remonte dans le temps et a installé la prédation permettant d’aboutir à la violence sexuelle. Il me semble que le livre de Vanessa Springora, justement intitulé Le consentement, ne raconte pas autre chose.
Pour une loi-cadre
Je ne propose évidemment pas de rester les bras ballants devant le classement sans suite de 86% des violences signalées à la police. Mais faisons attention à ne pas nous complaire dans des propositions impuissantes à modifier le réel. Quelle que soit la définition du viol, l’impunité se constate partout à travers le monde. Le cœur de la solution n’est pas dans le changement de définition légale mais dans la volonté politique à investir dans une loi-cadre, c’est-à-dire comportant des moyens financiers et humains.
Car le problème, c’est la culture du viol qui imprègne la société toute entière, des femmes qui renoncent à porter plainte aux juges et jurés qui ont généralement des stéréotypes plein la tête et une méconnaissance des mécanismes à l’œuvre, en passant par des policiers mal formés à recueillir la parole des femmes. Le problème, c’est le manque cruel de moyens pour la justice. Avec la déferlante MeToo, c’est peu dire que l’institution a été dans l’incapacité d’y faire face. Le problème, c’est la réduction de la dépense publique qui touche les associations et les services publics capables de faire reculer ces violences. Ce n’est pas la définition juridique qui est en cause mais son application. Et n’oublions pas que seules 6% des femmes victimes d’agression sexuelle, de viol et de tentative de viol déclarent les faits à la police ou gendarmerie.
Oui, il faut changer quelque chose pour que cesse l’impunité crasse. Faire entrer le consentement dans la loi semble à première vue frappé au coin du bon sens. Mais je me méfie toujours du « bon sens », c’est-à-dire de la première impression, par nature pétrie de pensée dominante. Saisir l’histoire de la notion et son ambigüité est essentiel pour viser juste, dans la loi mais aussi dans nos représentations. Je me méfie aussi des raccourcis car ils nous reviennent en boomerang. Nous ne pouvons pas contourner les mesures fondamentales : il faut dégager quelques milliards pour investir dans la prévention, la formation, le fonctionnement de la justice, l’accompagnement des victimes. Là est le cœur du combat. Et sur ce point, je sais que tout le Nouveau Front Populaire est d’accord. C’est essentiel.
Clémentine Autain